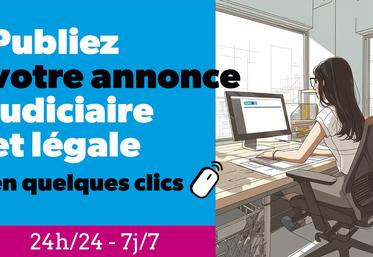Betteraves : aucune solution unique n'est efficace
En pleine campagne betteravière, la CGB a organisé une visite sur le terrain à Courpalay (Seine-et-Marne)mardi 4 novembre. Objectif affiché : mieux appréhender les dégâts de la jaunisse virale sur cette culture.
En pleine campagne betteravière, la CGB a organisé une visite sur le terrain à Courpalay (Seine-et-Marne)mardi 4 novembre. Objectif affiché : mieux appréhender les dégâts de la jaunisse virale sur cette culture.



Alors que la campagne d’arrachage des betteraves bat son plein, la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) a convié la presse à une visite de terrain à Courpalay sur l’exploitation agricole de Jean-Philippe Garnot, mardi 4 novembre. Outre la visite d’un chantier d’arrachage avec une intégrale, l’objectif était de comprendre les dégâts engendrés par la jaunisse sur cette culture quelques semaines après la censure de la loi Duplomb.
Interdiction des NNI et conséquences
« Meilleures seront les conditions de récolte, mieux sera implantée la culture suivante », a souligné le président de la CGB Île-de-France, Cyrille Milard, mettant aussi l’accent sur la nécessité d’optimiser la coupe au niveau du collet et le déterrage, rappelant que le collet libre comme le cordon de déterrage peuvent être des réservoirs à pucerons, insecte qui transmet la jaunisse à la plante.
« Pour faire face à la jaunisse, les exploitants disposaient, jusqu’en 2018, de semences enrobées traitées aux NNI (néonicotinoïdes) qui assuraient une protection durant 90 jours », a expliqué Fabien Hamot, agriculteur de la Somme et secrétaire général de la CGB, qui a rappelé la genèse de l’interdiction de ces molécules NNI et ses conséquences, notamment en 2020, année noire pour la production de betteraves en France. La perte a été estimée à 280 millions d’euros dans l’Hexagone. De plus, si les NNI sur semences sont interdits en Europe, la surtransposition française les interdit aussi par aspersion.
À ce jour, l’absence de diversité des modes d’action et la multiplication des passages accélèrent l’apparition de résistances. Le puceron se multiplie rapidement — entre le printemps et l’automne, quinze générations se succèdent. Et l’homologation d’une des rares molécules autorisée en France sur betterave, le Movento, expire ce 30 novembre. À contrario, partout en Europe, les agriculteurs disposent de protections efficaces (acétamipride en traitement foliaire et flupyradifurone en traitement de semences).
Par conséquent, en 2025, on assiste à une pression de la jaunisse sur l’ensemble du territoire avec les deux principaux impacts que sont une betterave plus chétive qui grandit moins vite et dont la richesse en sucre est moindre.
Recherche et innovation
Les conséquences économiques de la jaunisse en 2020 ont conduit à la mise en place du PNRI (Plan national de recherche et d’innovation) sur trois ans. Piloté par l’Inrae et coordonné par l’ITB (Institut technique de la betterave), il est prolongé par le PNRI-consolidé (2024-2026) afin de consolider les acquis et accélérer la mise au point de solutions opérationnelles.
Si les études menées ont permis de mieux connaître le puceron (vert du pêcher et dans une moindre mesure le puceron noir) et ses réservoirs viraux, le contrôle de l’insecte est difficile et les betteraves au stade jeune (moins de 12 feuilles) sont vulnérables. De plus, parmi les quatre virus qui touchent les betteraves, l’un d’eux peut avoir des conséquences au-dessus de 15 feuilles.
D’après un rapport récent de l’Inrae, aucune alternative opérationnelle aux NNI n’existe à ce jour. Parmi les leviers testés, certaines solutions sont inefficaces ou limitées (paillage, modulation azotée, bandes fleuries), d’autres sont prometteuses mais partiellement efficaces (plantes compagnes, huiles essentielles et médiateur chimique, larves de chrysopes). Et à ce jour, aucune variété résistante n’est encore disponible.
« On travaille surtout sur les pucerons car on ne sait pas lutter contre le virus. Il faut éviter les sources de contamination, ce qui relève d’une gestion collective voire interfilière sachant que moins de 1 % des pucerons sont vecteurs du virus », explique Fabienne Maupas, membre du comité scientifique du PNRI et responsable du département technique et scientifique de l'ITB.
L’observation des parcelles reste clé car la prolifération de la maladie est très rapide. Mais si le puceron est installé, il faut des solutions drastiques avec des produits.
Deux aphicides (le flonicamide et le spirotétramates) sont efficaces mais leur performance est insuffisante en cas de forte pression virale.
Il apparaît qu’aucune solution unique est efficace et qu’une combinaison de leviers est nécessaire : réduire les réservoirs viraux, perturber la reconnaissance visuelle et olfactive des parcelles par les pucerons et limiter leur dispersion et leur reproduction par biocontrôle ou produits aphicides.
« On a besoin d’un arsenal moléculaire. On ne peut pas continuer à jouer à la roulette russe. On espère des solutions car ce sont les dernières tonnes qui font le rendement. De plus, si on réduit les surfaces, on risque de perdre l’outil industriel. Il y a aussi un aspect moral de conduire une culture et de ne pas la maîtriser », a conclu Cyrille Milard.